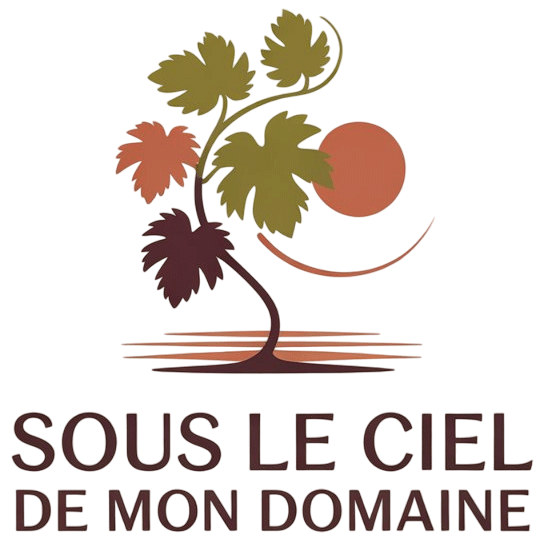Tour d’horizon des grandes zones géographiques et de leur impact sur le vin
1. Les coteaux calcaires du Quercy blanc : finesse, tension et fraîcheur
À l’extrême nord de l’appellation, en direction de Cahors, le “Quercy blanc” impose ses sols marno-calcaires. Sur ces collines orientées nord-ouest/sud-est, les amplitudes thermiques se creusent : +12°C de différence entre nuit et jour lors du mois d’août (Données Météo France 2022 pour Castelnau-Montratier). Résultat : maturités lentes, phénoliques plus progressives, ce qui profite au Cabernet franc.
- Profil des vins : notes vives de framboise, groseille, bouche serrée, acidité de garde. Les tanins sont droits, le vin a besoin de temps.
- Exemples notables : Les domaines autour de Montpezat-de-Quercy, tel le Château de Chambert (source : La Revue du Vin de France, 2023), proposent des cuvées alliant structure et grande buvabilité.
Ces coteaux sont aussi reconnus pour leur capacité à préserver la fraîcheur lors des millésimes chauds. Les parcelles les plus hautes bénéficient d’une ventilation continue, repoussant le risque de maladies et contribuant à un style pur, longiligne et très identitaire.
2. Les plateaux argilo-calcaires du Sud Quercy : puissance et intensité
Au sud, proche de Caylus et de Saint-Vincent, les vignes s’installent sur des sols argilo-calcaires parfois très caillouteux, issues de la décomposition du plateau calcaire primaire. La réserve hydrique y est meilleure, ce qui se révèle précieux face aux déficits en eau estivaux (moins de 600 mm de précipitations annuelles dans certains secteurs – Source : climatologie Météo France Tarn-et-Garonne).
- Profil des vins : structure plus appuyée, tanins abondants mais assouplis par la maturité. Fruits noirs, touche réglissée, évolution vers la truffe après 5-7 ans.
- Particularité : le Cabernet franc y joue à armes égales avec le Tannat, qui prend sur ces sols une dimension plus méditerranéenne, amplifiant texture et sapidité.
C’est ici, sur les reliefs dominant la vallée de la Lère, que plusieurs domaines travaillent à l’élaboration de cuvées de garde, élevées en fûts durant 18 à 24 mois, destinées à rivaliser avec les grands vins du Sud-Ouest voisin.
3. Les sables et galets des bords du Tarn : souplesse et rondeur
Autour de Montauban, l’influence de la rivière se fait sentir : sols alluvionnaires, composés de graviers, de sables et de galets. La vigne s’y développe rapidement, les rendements sont légèrement plus élevés (jusqu’à 52 hl/ha, versus 46 hl/ha dans les zones calcaires selon le CIVS, 2023).
- Profil des vins : fruité charmeur, tanins ronds, couleur soutenue mais structure plus légère. Ces vins se prêtent à un plaisir immédiat, sur la cerise noire, la violette, parfois la réglisse douce.
- Adaptation des cépages : Le Merlot prospère particulièrement, apportant souplesse et gourmandise, bien que proportionnellement inférieur au duo Cabernet-Tannat dans les assemblages AOP (maximum 30 % d’après le cahier des charges).
Cette zone accueille la majorité des vignobles en conversion bio et en diversification, avec 18 % de la surface en agriculture biologique sur l’aire Coteaux du Quercy en 2022 (DRAAF Occitanie).